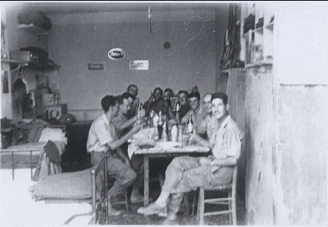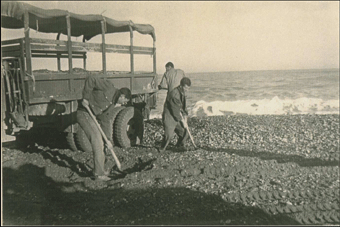|
Dossier de l'atelier histoire et mémoire
L’atelier Histoire et Mémoire de Soleil en Essonne a choisi de mettre la question des harkis à l’ordre du jour de ses échanges, en 2006 ; c’est le produit de ses travaux qui compose l’essentiel du dossier inséré dans le présent numéro d’AZRAK.
Les motivations qui nous ont poussés à cette étude répondent à l’objectif général de l’association : contribuer à renforcer la cohésion de notre société par les moyens de la connaissance et du dialogue.
De ce point de vue, la question des harkis nous interpelle à divers titres. Les harkis, dont l’identité même demande à être située, ont longtemps été invisibles dans notre société ; victimes d’une des plus grandes injustices qu’elle ait produite dans son histoire contemporaine, parqués dans des camps sur décision des autorités française, réduits au silence de plusieurs façons, objets de manipulations et d’attaques de sens contraires sur chaque rive de la Méditerranée, eux et leurs enfants ont fini par s’organiser pour faire entendre leur voix et respecter leurs droits.
Depuis quelques années, en France, des historiens se sont mis à travailler sur cette question, publications et colloques se multiplient, des associations de défenses des droits de l’homme se font entendre, des psychologues, des thérapeutes décrivent les symptômes du mal qui ronge sournoisement les familles de harkis, sautant parfois une génération, frappant comme au hasard l’un ou l’autre au sein d’une même fratrie…
Nous pensons qu’il est de notre devoir de solidarité humaine et de citoyen français de contribuer à une prise en charge collective de la parole à ce sujet. Ce travail de catharsis passe encore par le recueil ou le rappel de témoignages propres à alimenter une réflexion sur le sujet.
Nous n’avons pas l’ambition, bien sûr, d’aborder de façon exhaustive les différentes facettes de cette question ; nous renvoyons ceux qui voudraient en savoir plus à des publications citées dans la bibliographie présentée en fin de dossier.
Partie 1:
Le drame des harkis: entre manipulations et rejets
1 Les harkis vus par les européens
Avant l’indépendance
Peu importe si le nom de harki a désigné des personnes de statuts différents, moghaznis (policiers), GMS (groupes mobiles de sécurité), membres de groupes d’auto-défense (villageois non-rémunérés), et harkis bien sûr (supplétifs plus ou moins permanents). Cette appellation, surgie au cours de la guerre d’Algérie, a rapidement été utilisée pour tous les autochtones subalternes enrôlés aux côtés de l’armée, et même parfois à tort pour ceux qui étaient militaires d’active. Ce qui nous intéresse ici est que tous ces hommes ont été rangés dans la même page de l’histoire et ont partagé les mêmes drames à la fin de la guerre d’Algérie.
La perception dominante est celle d’une population espérant la victoire du parti français et ayant volontairement choisi d’y être associée. Les deux camps avaient tout intérêt à les percevoir et surtout les présenter ainsi : l’armée française et les défenseurs de l’Algérie française d’un côté, les partisans de l’indépendance de l’autre. Pour les uns le décompte des ralliements était le meilleur indicateur de l’adhésion du peuple aux thèses de l’armée et à l’Algérie française ; pour les autres, ils étaient inévitablement traîtres à la cause. En quelque sorte, il y avait un accord généralisé à leur sujet. Les journaux, la radio, la télévision naissante donnaient pleinement raison aux uns et aux autres.
En raison de cette classification, on pourrait penser qu’ils pouvaient être favorablement perçus par la population européenne. Il n’en était rien, et ceci pour deux raisons au moins. La première était leur quasi-invisibilité. Subalternes absolus et hommes des campagnes, ils n’apparaissaient que peu dans l’espace civil ou seulement en appui, sous la surveillance et le commandement de militaires français. La seconde, c’est que leur ralliement n’empêchait pas une suspicion certaine à leur égard ; leur sincérité ne pouvait pas être absolument garantie. Par exemple, c’est en ces termes que le mari d’une victime relatait la fusillade de la rue d’Isly du 26 mars 1962.1
« …On vous dit que des provocateurs OAS ont tiré sur les forces de l’ordre. C’est abominable ! N’en croyez rien. Je vous en supplie, croyez-moi, croyez votre Alfred qui ressent les plus grandes souffrances morales qu’un être humain puisse endurer. Dans les forces de l’ordre, parmi les soldats français, il y avait à l’entrée de la rue d’Isly (du côté de la Grande Poste) des soldats musulmans ayant la mine d’authentiques fellaghas. Nous faisions partie, tonton Antoine, ma Janine chérie et moi-même d’un immense cortège. Brutalement, un feu d’enfer, déclenché par les soldats musulmans placés à l’entrée de la rue d’Isly, fut dirigé contre nous. Feu d’enfer provenant d’armes automatiques de toutes sortes. Immédiatement, tout le monde se coucha sur le sol. Et pendant des minutes (peut-être dix, peut-être quinze, ce temps me parut une éternité) un feu nourri nous arrosa. Nous nous aplatissions sur ce sol, nous nous écrasions dans un réflexe de défense. A dix mètres de moi, il y avait sur le trottoir un soldat musulman. Avec des ricanements, des insultes, chaque fois qu'un pauvre allongé sur le sol levait le bras pour implorer la pitié, ce soldat tirait avec sa mittraillette et arrosait les malheureux couchés, tel un jardinier arrosant consciencieusement son jardin. C'était horrible...2
Le même livre rapporte plus loin le texte d’un tract de l’OAS rapportant ce drame où est mis en cause « un de ces fellaghas intégrés à l’armée française [qui] mitraille méthodiquement ces hommes et ces femmes couchés à terre…»
Même si le contexte a rendu ces écrits excessifs, ils reflètent à leur manière le sentiment et les appréhensions que partageait une grande partie de la population envers les "musulmans" de l’armée, à plus forte raison les harkis. On ne peut pas dire que là-bas ils aient été portés aux nues par le parti qui revendiquait leur ralliement ! D’une certaine façon ils se sont sentis méprisés de toutes parts. S’il n’y avait pas eu les cas de conscience d’officiers qui les connaissaient beaucoup mieux et avaient pris de bonne foi des engagements à leur égard, les Pieds-noirs ne se seraient pas tassés pour leur faire une place sur les bateaux de rapatriement.
Pendant la durée du conflit, peu de gens se sont vraiment intéressés à eux, comme à tous ceux qui étaient ballottés d’un bord à l’autre. Par exemple, ce n’est qu’en 2003 que le rapport courageux et lucide produit par le jeune stagiaire Michel Rocard sur les camps de regroupement a été publié et les a fait connaître. On sait que ces camps qui étaient dans la dépendance absolue de l’armée ont pu être des lieux privilégiés de son influence et peut-être de ses ralliements forcés. Toutes ces populations, et les harkis n’y font pas exception, vivaient
hors du regard des journalistes loin des rares zones qui leur étaient accessibles. L’information a bien mieux traité les combattants des maquis.
Ce jour-là, l’OAS, retranchée dans le quartier populaire de Bab el Oued et entrée en guerre ouverte avec l’armée française, avait lancé une manifestation, y invitant femmes et enfants pour contraindre l’armée française à prendre son parti ou au moins relâcher sa pression. Parvenue rue d’Isly, au centre d’Alger, la manifestation s’était heurtée à un barrage d’une section de tirailleurs algériens. Des coups de feu partis d’on ne sait où ont
déclenché une fusillade générale faisant 56 morts et 150 blessés chez les manifestants ou ceux qui leur portaient
secours"
Françoise Mesquida A la porte de l'oued (l'harmattan 2003)
Après l’indépendance
Sitôt après l’indépendance, les harkis désarmés ont été les proies faciles des "résistants" de la dernière heure, ceux qu’en Algérie on appelle les "marsiens" en raison de leur engagement sans risque après les accords d'Evian de Mars 1962.
Ainsi l'annexe IV3 d'un livre du général Maurice Challe3 reprend une série de témoignages datant d'octobre 1962 décrivant en détail les atrocités subies. « Alors, pendant trois jours les civils conduits par les fellaghas nous ont battus à coups de bâtons, de pierres. Nos femmes ont subi le même sort que nous. Après ces trois jours nous étions presque morts, nous quatre et nos femmes, couverts de plaies, surtout à la tête. Mais ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont remis dans la maison. Mon frère a pu me dire qu’ils allaient nous tuer. J’ai pu me sauver au
moment où on allait m’attacher les mains. Je sais qu’un autre s’est échappé aussi, mais il avait les mains attachées derrière le dos : il a du être repris et tué. Je me suis caché quinze jours dans la forêt. Mon frère, la nuit, a pu me donner de la galette et un peu d’argent. J’ai gagné Fedj M’Zala puis Saint-Arnaud. J’ai pris le train pour Alger où je suis arrivé le 19 août. A la gare, j’ai été au bureau français. J’ai obtenu un billet pour Marseille, puis pour Paris. Avant le départ du bateau à Alger, la police F.L.N. est montée à bord contrôler les musulmans. Elle a pris trois goumiers qu’elle a fait débarquer. Moi je n’étais pas sur leur iste. Voilà ce que sont devenus les autres de la S.A.S. : D’abord ils ont sûrement tué ma femme et peut-être mon fils après mon évasion. » Cet extrait n’est pas le plus insupportable du contenu de cette annexe, mais rend parfaitement compte du climat dans lequel ces faits se déroulaient.
Une fois encore, ce sont les militaires consignés dans leurs casernes après le cessez-le-feu qui ont assisté à ces exactions et apporté leurs témoignages au milieu d’une indifférence assez générale. Ces faits ne mobilisaient plus une opinion désireuse de tourner la page, comme ne la concernaient pas les disparitions d’Européens en Algérie à la même époque.
De même également, la France qui ne s’était aucunement préparée à accueillir les "rapatriés" était encore moins disposée à le faire pour les harkis dont la présence n'était pas désirée. Plus étrangers que tous les autres, eux n'avaient aucune famille pour les recevoir, n'ont été une priorité pour personne et sont restés le problème des seuls militaires et de quelques âmes généreuses qui se sont émues de leur sort.
Ainsi ont été récupérés ou organisés des camps, dont certains de sinistre mémoire encore entourés des barbelés de leur utilisation précédente, où l'ordre et les traditions militaires se poursuivaient naturellement à commencer par le lever des couleurs. Là encore, la population environnante éprouvait plus de gêne que d'attirance pour ces populations si différentes, déracinées, peu adaptées à la vie en France, portant les tristes marques d'une fuite précipitée dans un climat de haine. Leurs réelles difficultés de communication ne faisaient que compliquer les choses.
Les Pieds-noirs des mêmes régions étaient bien trop préoccupés par leur propre insertion pour se préoccuper des harkis. Ils se rendaient plus facilement aux invitations du bachaga Boualem que dans leurs camps. En cela, on ne voit pas pourquoi leur attitude aurait été différente de ce qu'elle était en Algérie. En raccourci, on peut dire qu'il n'y a eu qu'une simple transposition d'une situation d'une rive à l'autre, bien plus douloureuse pour les harkis et leurs familles qui perdaient tous leurs repères.
Habitués et contraints d'adopter un profil bas, ils n'avaient d'autre choix que de revendiquer plus fort leur attachement à la France pour tenter d'obtenir quelque reconnaissance, sinon un peu de considération. Le faisant, ils s'enfermaient davantage dans le rôle qu'on leur avait toujours assigné et ne parvenaient qu'à justifier leur exploitation par les nostalgiques de l'Algérie française.
C'est finalement la révolte de leurs enfants, principalement contre le dédain et l'humiliation dont ils étaient victimes, qui a fait surgir les questions les concernant. Depuis le tournant du siècle, il est maintenant possible d'aborder plus sérieusement leur histoire.
Notre révolte (Presses de la cité, 1968)
2. Extraits de deux interventions au Colloque
« 1956-2006 : 50 ans, les harkis dans l’histoire de la colonisation et ses suites », Paris, mars 2006
Combien furent-ils ?
Extrait de l’intervention de Monsieur François-Xavier HAUTREUX, Doctorant en histoire contemporaine à l’Université Paris X Nanterre
« La question des effectifs est importante et quasiment impossible à résoudre : si on dispose d’effectifs réguliers pour les harkis, aassès, mokhaznis et GMPR, déjà, en ce qui concerne les GAD, la précision est beaucoup plus aléatoire. De plus, on l’a vu, il existait des harkis “ fictifs ”. La même observation se répète pour les mokhaznis. Concernant cette catégorie ainsi que les GMPR, on sait également qu’un certain nombre d’européens y servirent, et malheureusement, les sources dont nous disposons font rarement la distinction.
De plus, on ne dispose dans les archives que d’estimations à un instant T, et pas d’estimation globale pour toute la durée de la guerre. Il est très difficile de connaître l’importance du roulement des effectifs, notamment pour les harkis dont les contrats sont extrêmement instables.
On peut donc seulement savoir qu’au moment de leur plus fort emploi, c'est-à-dire entre la fin 1959 et 1961, il y avait entre 56 et 60 000 harkis déclarés, environ 8 000 GMS, 20 000 mokhaznis, 3000 aassès et que 28 000 armes étaient attribués aux GAD qui étaient censés regrouper jusqu’à 60 000 hommes par roulement. On voit le degré d’imprécision. Si on compte à maxima, on arrive à un total de 150 000 hommes. Néanmoins, compte tenu des imprécisions évoqués plus haut et ne prenant en compte que les membres armés des GAD, on arrive à une fourchette comprise autour de 100 000 hommes. Ceci à un même moment. Savoir combien d’Algériens servirent à un moment donné dans une des différentes unités supplétives est actuellement impossible. Les estimations retenues aujourd’hui tournent autour de 200 à 250 000 hommes, je vous les donne à titre indicatif : ce total ne me semble ni exagéré, ni trop faible, mais je n’ai moi-même actuellement aucun moyen de le vérifier.
La raison pour l’état major de recruter autant de supplétifs musulmans ne tient pas tant à leur intérêt pour les opérations en cours que pour des motivations psychologiques visant à montrer aux algériens, à la métropole et au monde entier que les français musulmans se battaient principalement du côté du drapeau français et à nier la possibilité même de l’indépendance algérienne. Ce type de raisonnement semble d’ailleurs persister dans certains cercles.»
Des camps de transit : solution pour les « réfugiés musulmans » ?
Extrait de l’intervention de Monsieur Abderahmen MOUMEN, Doctorant en Histoire
(Université de Provence, Laboratoire IEA)
« Dans une période de crainte de la récupération politique des anciens supplétifs par l’OAS, crainte relayée par ailleurs dans la presse et particulièrement la marseillaise, des camps de transit sont mis en place à l’intention des réfugiés. Ainsi arrivés par ces divers biais, nombre d’anciens supplétifs, seuls ou accompagnés de leurs familles, sont envoyés dans des camps mis en place par l’Etat français à leur intention spécifiquement. Ces camps ont une double mission : l’hébergement et le triage des anciens supplétifs rapatriés, comme le précise une
note du Ministre des rapatriés en septembre 1962. « Le camp doit répondre à un double but :
1) hébergement temporaire des familles en attendant leur dispersion vers d’autres lieux (…) ;
2) triage des nouveaux débarqués en instance d’acheminement »4
Cette solution est ainsi sensée être provisoire pour affronter cette situation d’urgence. Dans un premier temps, au cours du mois de juin, deux camps sont crées au Larzac dans l’Aveyron et à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. Rapidement saturés, quatre autres camps sont constitués durant l’automne 1962 : à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Maurice l’Ardoise dans le Gard, à Bias dans le Lot-et-Garonne et à La Rye-Le Vigeant dans la Vienne, à l’intention exclusive des civils. Ces rapatriements de réfugiés musulmans sont cependant imprégnés d’une chape d’invisibilité : les « rapatriés officiels » débarquent au Cap Janet à Marseille, partie du port la plus reculée de la ville, à une heure tardive de la nuit. Regroupés dans un hangar, ils sont ensuite envoyés par train, qui vient les chercher jusque dans le port, pour les diriger vers les camps de transit. En ce qui concerne les « rapatriés officieux », l’invisibilité côtoie la clandestinité des filières. »
ROUX Michel, Les Harkis : les oubliés de l’histoire, 1954-1991, Paris, La Découverte, Collection Textes à l’appui. Série histoire contemporaine, 1991, p.244
3. Un débat
Extrait du site de la Section toulonnaise de la Ligue des Droits de l’Homme. Par Fatima Besnaci-Lancou, présidente de l’association Harkis et droits de l’Homme et François Nadiras, Section toulonnaise de la Ligue des Droits de l’Homme.
« Un article de Karim Kettani intitulé "Paradoxe : un ministre harki (Hamlaoui Mékachéra)renvoie une conseillère pour cause de parenté avec un collabo (Papon) " avait attiré notre attention.
Certes, on peut comprendre que des associations de déportés se soient émues de la présence au sein du ministère de la mémoire d’une personne dont le grand-père a été condamné pour "complicité de crime contre l’humanité ". Mais nul n’est responsable des agissements de ses parents et grands-parents. Et Serge Klarsfeld a raison d’estimer que cette éviction relève d’"un cas de discrimination pure et simple ".
Cependant, puisque Karim Kettani insiste et nous cite dans un nouvel article, nous en profitons pour aborder ce qui nous paraît être le fond du problème. Nous sommes en effet choqués que le terme "harki " puisse continuer à être utilisé couramment de façon dépréciative et même comme une injure, en Algérie et en France.
Les harkis étaient les soldats de certaines unités supplétives autochtones recrutés par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Mais cette appellation recouvre une réalité complexe ethétérogène. Tous n’ont pas eu la possibilité de choisir : la violence française a été accompagnée d’enrôlements forcés, et la propagande de guerre a tiré parti de l’image de ce "loyalisme ".
Comme l’écrit Mohamed Harbi, "Quand on analyse cette population harki, on est confronté à une réalité sociologique très hétérogène où on trouve essentiellement les classes les plus faibles de la population et les plus liées à la tradition et à la religion, des groupes de population pris entre deux feux et jouant le double jeu, ayant un membre de la famille dans l’ALN et un autre harki. Il y avait aussi des résistants de la première heure qui connurent, après leur arrestation, les pires tortures, ce qui explique certains abandons, enfin des déçus de la résistance. "
Un ancien maquisard ou un sympathisant du FLN pouvait également devenir harki, pour des raisons que l’on pourrait qualifier d’absurdes. Dans un de ses livres , l’ethnologue Germaine Tillion a illustré ce cas par une histoire vraie. Dans un village de Grande Kabylie, elle raconte qu’un règlement de comptes a eu lieu sous couvert de ce qu’elle appelle les trois guerres : « un collecteur du FLN est dénoncé par un ennemi héréditaire ; traqué, puis « retourné », il accepte de se faire « harki ». Le voilà libre, avec une solde et un fusil. Sans traîner, il assassine celui qui l’a dénoncé, et ensuite, comme il se doit, la famille du mort se met à surveiller les allées et venues du harki. Elle le tue. A-t-elle tué un ancien FLN ou un ennemi du FLN ? Qui venge-t-elle ? L’ennemi d’un harki ou un agent de renseignement français ? »
Il faut que nous, les vivants, comprenions que cette guerre nous traverse tous, et qu’il esttemps de "dire enfin que la guerre (d’Algérie) est finie" (Mohamed Harbi).» « Je suis tout à fait d'accord avec les propos de François lorsqu'il souligne la complexité et les nuances nécessaires pour décrire les motivations disparates des harkis - la nuance et la complexité étant par ailleurs au rendez-vous de l'autre bord, celui des nationalistes algériens et de leurs soutiens étrangers (de très nombreux Tunisiens, Marocains et Français se sont en effet joints à la lutte du peuple algérien pour son indépendance).
Mais ces nuances et cette complexité sont banales dans une situation historique aussi dramatiques que la guerre d'Algérie - elles étaient ainsi présentes, sans faire de fixation sur cette période ni d'amalgame facile, dans la période de l'occupation allemande de la France, et ma référence au film de Louis Malle, "Lacombe Lucien", n'a rien de fortuit. Les motivations ayant poussé telle personne à résiter et telle autre à collaborer sont complexes - des communistes furent collabos, et des fascistes résistants (je pense au cas de Georges Valois, fondateur du premier mouvement fasciste français, mort en déportation pour faits de résistance). Parfois même, ainsi que le décrit Germain Tillion dans le cas cité par François, une même personne pouvait passer d'un bord à l'autre - François Mitterrand en fut un exemple éclatant.
Mais cette complexité des motivations n'empêche en rien que l'on, qualifie le comportement objectif des personnes en question: le collabo idéologiquement convaincu sera, à mes yeux, plus responsable que celui pour lequel la collaboration n'aura été un acte de vengeance personnelle, ou une démarche purement alimentaire. Faisons la comparaison avec le droit pénal: les motivations du prévenu n'influent pas sur sa culpabilité - soit il a commis les faits délictueux, soit il ne les a pas commis. Elles peuvent (et doivent) par contre intervenir lors du
prononcé de la peine. Je ne dis rien d'autre à l'égard des harkis et des collabos - ils sont coupables de trahison, mais pas forcément au même titre.
PS: Hamlaoui Mekachera entretient l'amalgame que dénonce François Nadiras, puisqu'il préside depuis 1991 le Conseil National des Français Musulmans, une des principales associations de défense des harkis...»
Partie 2
Une souffrance toujours là
1. Histoire de Victor.
Extrait de l’intervention de Madame Patricia FOUASSIER-LAFFAGE, Psychologue clinicienne,
au Colloque « 1956-2006 : 50 ans, les harkis dans l’histoire de la colonisation et ses suites », Paris, mars 2006.
« Nous sommes en 2004 dans un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de la banlieue parisienne, qui a pour mission de soigner des enfants souffrant de psychose et d’autisme…
« Victor est l’un d’eux, il crie par tout son être son angoisse indicible au travers de symptômes que je vais vous décrire en quelques mots…
Victor peut se montrer très calme et concentré lorsqu’il est seul avec un adulte, la présence des autres enfants le déstabilise rapidement, il se replie alors dans des rituels ou des stéréotypies langagières (mélopées qui le bercent, écholalies). Il peut aussi pousser des cris stridents dont la signification n’est pas toujours aisée à saisir…
Victor ne rit jamais : « Le drame est toujours au coin du bois » pour lui ! Quant à son regard, il semble traverser les êtres. Toute l’énergie de cet enfant semble focalisée dans l’évitement de la pensée, de l’émotionnalité…
Une curiosité nouvelle s’est faite jour en moi quant à l’histoire familiale de Victor prise dans le cadre plus large de l’histoire de la guerre d’Algérie.
Le dossier, qui suit l’enfant depuis plusieurs années, ne dit rien à ce sujet…Et pourtant, ma pensée mise au service de Victor pressent un drame, un événement réel dans cet univers fantasmatique.
J’insiste auprès de la pédo-psychiatre qui reçoit la famille depuis trois années, pour qu’elle investigue davantage. Plus d’un mois s’écoule avant que la justesse de mon intuition me soit renvoyée.
Les parents de Victor se montrent depuis le début de la prise en charge de leur enfant très gentils, coopératifs, pour ne pas dire extrêmement soumis aux décisions qui doivent être prises pour leur fils. Imperturbablement lisse, leur attitude ne laisse aucune prise à rien, n’exprime aucun vécu émotionnel. Ils sont parfaitement insérés et c’est le plus important semble-t-il pour eux !…
Et pourtant, sur mon insistance, la pédo-psychiatre, au détour d’une question, voit la mère de Victor éclater en sanglots.
Oui, il s’est passé quelque chose de terrible dans cette famille ! Le grand-père de Madame était harki, il se battait pour la France pendant la guerre d’Algérie. Au cours d’une permission, alors qu’il revenait dans son village de Kabylie, il a été assassiné par deux maquisards du F.L.N ; son corps n’a jamais été retrouvé, il n’a donc pas pu être enseveli et avoir une tombe où ses proches puissent se recueillir.
De surcroît, l’armée française n’a pas reconnu sa mort en service, prétextant que ce combattant était en fin de contrat, laissant sa veuve enceinte du quatrième enfant dans le dénuement le plus total. Le père de Madame avait alors douze ans. La famille est restée au village, mais à quel prix !
Ils ne pouvaient circuler sans être épiés de tous. On chuchotait sur leur passage :« C’est la famille du traître ! », ce qui ne manquait pas d’avoir un impact sur leurs déplacements. Ils se sentaient menacés de toutes parts, mis au ban de la société. Le père de Madame a continué de vivre toute sa vie comme cela…
La honte joue un rôle important dans les influences qui auront cours entre les générations. Une honte familiale totalement recouverte par le silence pourra s’exprimer plus tard par des maladies psychiques ou physiques chez les descendants. Les conséquences graves de tels secrets peuvent exister pour les générations ultèrieures, même si les faits honteux qui ont affecté l’un ou l’autre des parents sont finalement inconnus par les descendants. Ces traumatismes non surmontés peuvent être de nature familiale, mais aussi s’inscrire dans
l’histoire collective, comme c’est le cas ici…
Les premières traces de cette histoire indicible se manifestent tout d’abord par des mots fétiches : cimetières, squelettes, prison, mort , chez Victor. Des mots-choses à partir d’images dont on ne sait si elles proviennent de rêves, de fantasmes, ou de souvenirs…
Les témoignages sur la dernière guerre nous montrent à quel point l’attitude de l’entourage et l’ensemble des circonstances familiales et sociales sont importantes pour le déroulement du deuil. Il est indispensable que le vécu puisse être couché dans la mémoire de l’humanité et d’abord dans celle des personnes directement concernées, de leur famille et de leur descendants, auquel cas le traumatisme clivé, devenu destructeur, va constituer une véritable préhistoire de l’histoire personnelle des descendants. Comme je l’ai déjà dit, la honte joue un rôle principal dans ce silence partagé. Il suffit de se rappeler les deux épisodes qui ont fragilisé la maman, épisodes liés à la dénonciation faite par les voisins quant aux cris de Victor, ou sa violence. Cette volonté de se mouler sans bruits dans le tissu social français n’est pas sans lien avec le poids de la culpabilité du harki et de ses descendants, puisque ce titre est synonyme de traître pour les algériens et de mauvaise conscience pour les Français.
La mauvaise conscience draine son lot d’amnésie et d’oublis pour les personnes mais également pour les institutions. La structure de soin est tombée, elle aussi, dans un trou de mémoire, à tel point que le dossier de cet enfant, relativement succinct, passe sous silence la réalité des harkis dans l’histoire de Victor. On assiste là à une véritable duplication du symptôme de Victor, l’absence, le trou, le vide sur lesquels aucun sens ne peut se construire,sont repris en écho. Toute institution est bel et bien prise dans la grande Histoire et à ce titre
répète compulsivement ce qui s’y joue. Véritable analyseur de l’avancée des mentalités,
l’histoire des hommes, cette histoire qui nous tend notre miroir, ce poids culturel pèse profondément sur nos organisations identitaires.»
2. Le silence des vieux harkis d’un Foyer Sonacotra
Le 27 avril 2006, un groupe de travail de l’association Soleil en Essonne rencontre une quarantaine de résidents d’un Foyer Sonacotra de l’Essonne ; l’objectif est de mettre en place un groupe de parole pour tenter de dépasser un certain nombre de problèmes de relations externes et internes au Foyer.
Les gens de l’association présentent le projet qui prévoit de partir de contes maghrébins et africains pour délivrer la parole des résidents. Mais à un moment donné, la réunion prend une tournure quelque peu conflictuelle. Extrait du Journal de bord de l’action :
« A., cependant, continue de s’agiter dans le fond et à la fin, il dit que lui aussi pourrait raconter. Nous lui proposons de venir à la « tribune » ; il s’y refuse d’abord, prétextant qu’il ne veut pas blesser des compatriotes. Nous ne comprenons pas. Il insiste, et avec un geste circulaire désignant l’assemblée, il lance : «Vous comprenez, ils ont violé des femmes ! ».
Nous comprenons alors qu’il parle de harkis, dont nous savons qu’il s’en trouve plusieurs au Foyer. D’ailleurs, un, puis plusieurs vieux se lèvent et sortent. Nous n’avons pu prévenir cet incident. A. « monte » alors jusqu’à nous et un bref échange a lieu, où il s’avère qu’il n’a pas de contes à raconter, mais des récits de la guerre d’Algérie. »
A. finira par être convaincu de l’intérêt du projet dont il deviendra, au cours des semaines suivantes, un chaleureux participant. Par contre, les harkis qui se sont retirés le premier soir ne sont plus revenus. Ils ont replongé dans le silence de leur solitude.
Partie 3
Justice pour les Harkis
Prises de positions, points de vue
1. Dire enfin que la guerre est finie
par Mohammed Harbi, historien, ancien dirigeant du FLN.
Point de vue paru dans le Monde du 4 mars 2003
« Encore un cri, celui de Fatima Besnaci-Lancou, qui vient nous rappeler que la guerre d’Algérie n’est pas finie pour tout le monde et que bien des plaies restent ouvertes. Son livre, Fille de harki, vient après l’ouvrage de Saïd Ferdi, Un enfant dans la guerre, quiraconte comment, enlevé à sa famille en 1958, il fut enrôlé de force dans l’armée française alors qu’il n’avait que 14 ans. Ces témoignages nous prennent à la gorge et nous invitent à
repenser le drame algérien dans sa complexité et en abandonnant bien des idées reçues.
Il est une catégorie qui a la force d’un mythe et qui veut organiser la réflexion sur ce drame, à partir du couple résistance patriotique du peuple algérien et collaboration avec l’ennemi des harkis. Ce type de simplification vient de la comparaison avec d’autres expériences historiques. Mais comparaison n’est pas raison. C’est commettre une erreur d’appréciation historique que d’assimiler le combat des Algériens pour la naissance (ou la renaissance) d’une nationalité à la guerre entre deux vieilles nations comme la France et l’Allemagne dans la guerre de 1939.
On ne peut pas ne pas tenir compte de l’existence, en Algérie, après cent trente ans de colonisation et un statut de "département français", de forces sociales indifférentes à l’idée nationale. Une anthropologie de la construction de la nation algérienne est indispensable pour comprendre le phénomène harki. L’enjeu est d’importance, car, dans la situation actuelle, il peut être un des chemins qui mène à l’invention démocratique.
Il ne s’agit aucunement de mettre en question les objectifs du FLN durant ces dures années d’une guerre de libération sans merci. Mais sa contribution à l’indépendance de l’Algérie a été souvent mise en évidence, et c’est très légitimement que les ouvrages honorant son action sont nombreux. Mais la véracité oblige aussi à ne plus occulter les durs conflits de certains combattants avec plusieurs populations rurales et dont le résultat fut de fournir un grand nombre de supplétifs à l’armée française.
Il serait malhonnête d’impliquer dans ces comportements l’ensemble des patriotes. Reste que les exemples sont nombreux où se manifeste une absence de retenue, des brutalités engendrant une violence en retour et, d’une façon générale, un manque d’intelligence politique dans la conduite de la guerre. Preuve en est les rappels à l’ordre, à ce sujet, de l’état- major de l’ALN et du GPRA.
Une gestion condamnable des rapports avec la population paysanne, le peu d’attention accordé à sa situation matérielle, les atteintes au code de l’honneur ont permis à l’armée française - la crise rurale, des situations parfois proches de la famine, enfin les pressions
aidant -, de recruter et d’armer des groupes en leur sein et, ainsi, de bouleverser les termes du conflit en lui donnant une forme plus violente et l’allure d’une guerre civile.
Ce qui est à noter - et c’est là une dimension essentielle pour comprendre ces phénomènes, c’est que les harkis ne nourrissaient aucun projet politique, ni pour eux-mêmes ni pour les populations dont ils étaient originaires. Ils n’ont d’ailleurs produit aucune idéologie de la collaboration, sorte de Manifeste pour un parti de la France. C’est bien davantage dans les villes que parmi eux que se recrutèrent ceux qui auront tourné le dos à un mode de vie
communautaire pour s’assimiler culturellement.
Quand on analyse cette population harki, on est confronté à une réalité sociologique très hétérogène où on trouve essentiellement les classes les plus faibles de la population et les plus liées à la tradition et à la religion, des groupes de population pris entre deux feux et jouant le double jeu, ayant un membre de la famille dans l’ALN et un autre harki. Il y avait aussi des résistants de la première heure qui connurent, après leur arrestation, les pires tortures, ce qui explique certains abandons, enfin des déçus de la résistance.
En 1962, en contradiction avec les accords d’Evian, l’Algérie a connu la vengeance des faibles contre les faibles, quelquefois avec l’acceptation muette des résistants.
C’était la conséquence fatale des épreuves subies par les Algériens. L’esprit de vengeance, profondément enraciné dans la culture populaire, a prévalu sur le souci de justice. Les jugements sommaires, les exécutions ne furent pas désavoués. Les surenchères furent surtout celles des résistants de la dernière heure qui voulaient canaliser à leur profit les rancoeurs populaires et s’approprier les dépouilles laissées par les Français d’Algérie.
La France en 1945 et d’autres pays ont connu ce genre de situation, mais qui fut mieux canalisée par les pouvoirs légitimes en place.
Ce qui peut se comprendre dans les exaltations, les remous et les difficultés des premiers temps de l’Algérie indépendante prend aujourd’hui une tout autre signification. Comme si était un principe politique que de dire, comme dans la Bible, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Les fils et les filles sont-ils stigmatisés à jamais ? Et est-ce là bonne politique ? Les enfants de harkis, en France,
Algériens de coeur autant que Français de nationalité peuvent être un levain pour les relations entre la France et l’Algérie. Un levain, pas un obstacle.
Il faut ajouter que la réalité d’aujourd’hui n’est plus celle de l’intransigeance. Celle-ci est celle que veulent présenter les pouvoirs en place. Bien des harkis sont retournés depuis dans leurs villages et ils y ont rencontré indulgence, oubli ou compréhension des paysans, leurs semblables. C’est ce que montrent nombre de témoignages que nous offre le livre de Nordine Boulhais (Des harkis berbères, de l’Aurès au nord de la France). L’opinion
populaire est plus avancée que celle des dirigeants ? Est-ce étonnant ? » Fatima Besnaci-Lancou met surtout l’accent sur ses épreuves en France, sur les camps qui "accueillirent" les harkis ? C’est l’histoire du calvaire d’une Algérienne, une suite de la guerre d’Algérie que l’Algérie doit entendre. Et proclamer que, oui, la guerre est finie.
2. Fils de harki: l’enfant caché
Un point de vue d’Algérie.
Par Abdou B., Journaliste, Le Quotidien d’Oran. Décembre 2003.
«Lorsque Le Sage Montre La Lune, L’idiot Regarde Le Doigt»., Proverbe Chinois
« Point litigieux, abcès hérité d’une terrible guerre d’indépendance, problème humain et enjeu politique, les harkis et leur descendance ont régulièrement alimenté la chronique tumultueuse des relations algéro-françaises. Depuis leur départ vers la France, avec l’indépendance de l’Algérie, les harkis ont subi les pires humiliations sur le sol français.
«Français-musulmans», ils n’étaient ni Français à part entière ni Algériens puisqu’ils avaient, suite à leur engagement à tous les niveaux, opté pour une «Algérie française» dont les jours étaient comptés à dater du Premier Novembre 1954. Problème francofrançais, les harkis ont été parqués comme des bêtes sans pedigree, dans des camps dépourvus d’électricité, d’eau et de sanitaires.
Enfants illégitimes, cachés aux quatre coins de l’Hexagone, ils étaient de parfaits inconnus au sein de «la mère patrie». Avant leur organisation, beaucoup plus tard, en lobby politique, ils étaient carrément invisibles pour les partis et la société française. De nombreux documentaires, des romans, des études avaient décrit leur misérable quotidien, leur français approximatif, leur déracinement et leur hébétude dans une
société de consommation, déchargée du fardeau de la guerre d’Algérie qui vivait au rythme du twist et s’habillait vichy avec les fameux vêtements à carreaux popularisés par Brigitte Bardot, star incontestable de la France de l’époque. Seulement, ces harkis avaient avec eux des bébés, des jeunes enfants qui ont eu par la suite des frères et soeurs nés en France, donc Français.
Toute une génération dite «fils de harkis», un label tantôt infamant, toujours hybride, s’est trouvée écartelée à travers des mémoires composites des bribes d’histoire, humiliée par le statut dans lequel étaient enfermés leurs parents, rattrapée par une guerre qu’elle n’a ni connue ni faite. Et cette génération complètement innocente fait aujourd’hui problème, des deux côtés.
Il faut avoir rencontré ces jeunes, dans les festivals en France et plus tard durant Djazaïr 2003 pour mesurer le désarroi, le sentiment d’une culpabilité diffuse, confuse, à chaque fois que des fils de harkis assistaient à la projection d’un film algérien, à chaque fois que dans une oeuvre, une allusion était faite aux harkis, à la France, à la guerre de libération, etc. Leur soif de connaître le pays d’origine de leurs parents, leur manière extrêmement
gênée de s’informer, de vouloir comprendre une guerre longtemps et laborieusement occultée par le père ou la mère, par l’Etat français, indique la profondeur d’un problème humain que les classes politiques, ici et là-bas, ont toujours refoulé par des manoeuvres politiciennes.
Aujourd’hui se pose entre l’Algérie et la France la question de la libre circulation des harkis et de leurs enfants. Pour les premiers, qui sont Français, ne l’oublions pas, la problématique complexe renferme cependant en elle-même les éléments de réponse. Considérés par de larges couches de la population en Algérie comme des traîtres et des collaborateurs, le problème de leur sécurité saute aux yeux. Qui prendrait une telle responsabilité à l’égard de ceux qui seraient estimés (comment et par qui ?) innocents des crimes de sang, d’actes de tortures, des brimades, d’opérations militaires menées avec l’armée française jusqu’à la fin des hostilités entre l’ALN-FLN et les forces d’occupation ? Il ne faut pas jouer avec le feu et demander à l’Algérie de pouvoir éviter
ce que la France n’a pu faire à la libération, après la défaite du nazisme. Exécutions
sommaires, crânes de femmes rasées, procès en cascade dans tous les milieux, jugementd’officiers supérieurs ont traumatisé et divisé la France durant longtemps.
Cependant, pour les enfants des harkis, le dossier se pose autrement. Il s’agit de Français dont les noms résonnent bel et bien algériens et qui sont parfaitement innocents. Comme le sont Guy Bedos, Roger Hanin, Jean-Claude Brialy. Ces pieds-noirs qui n’ont pas pris part à la guerre d’Algérie sont toujours les bienvenus sur le territoire algérien. Bien sûr, durant des décennies, selon les conjonctures politiques, le dossier est tantôt exhumé, tantôt remisé dans les tiroirs de ministères froids et impersonnels. Les harkis ont souvent été une carte électorale, une forme de continuité d’une guerre pouvant être achevée. Ici et là-bas, beaucoup ont essayé de participer a posteriori à un conflit qu’ils ont observé de loin, manipulant l’histoire, l’écrivant selon le moment ou la falsifiant.
Les pères fondateurs de la révolution algérienne, à de rares exceptions, ont eu une vision hégémonique articulée autour de la pureté révolutionnaire et autour de rejet absolu des traîtres auxquels sont abusivement assimilés les fils de harkis. Du côté français, la réflexion avait tendance à faire dans le package: pieds-noirs, harkis et leur descendance. Dans les deux cas, les positions ne sont plus tenables. Les êtres humains sont des sujets
différents et le fils n’est pas responsable des actes de son père. Et si personne ne choisit le lieu de sa naissance, on ne choisit pas non plus ses parents.
La rationalité, dans le cas présent dans les relations algéro-françaises, impose de sérier les problématiques. Les Etats des deux pays ont affaire à trois catégories de Français: les pieds-noirs, les harkis et les enfants de harkis. Ces derniers sont libres d’aller et venir entre la France et l’Algérie, pour le reste chaque cas représente un être humain avec son parcours à nul autre pareil, et il faut parfois donner du temps au temps. »
3. Harkis : une loi-geôle.
Communiqué de presse, lundi 28 février 2005
Par Fatima BESNACI-LANCOU Présidente de l’Association Harkis et Droits de l¹Homme
« Le 23 février 2005 est promulguée la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Après les camps, derrière les barbelés, les harkis et leurs familles viennent d’être enfermés dans une loi abjecte votée par des nostalgiques de l’Algérie Française.
Le texte figurant au journal officiel du 24 février 2005 s’ouvre par l’article : « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. » Les parlementaires associent les harkis, à leur corps défendant, à la promotion du colonialisme.
Le texte se termine par l’article 13 : « Peuvent demander le bénéfice d’une indemnisationforfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l’objet, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale. »
Derrière ces personnes se cachent les anciens membres de l’« O.A.S. » Pourquoi ne pas appeler un chat, un chat ? Nos élus ont-ils peur de l’indécence ? Ils ont été moins scrupuleux en scellant le destin de leurs français-indigènes aux détracteurs de l’indépendance de l’Algérie.
Concernant l¹article 6 relatif à l’indemnisation des harkis, la loi a un goût de charité et non de justice. Le rapport demandé par le premier ministre au député Michel Diefenbacher (UMP, Lot-et-Garonne) et sur lequel s’est basé le gouvernement pour la rédaction de la loi ne s’intitulait-il pas "Parachever l’effort de solidarité envers les rapatriés" ?
Pourquoi donner plus à ces femmes, ces enfants et ces hommes que l’on a abandonnés à l’indépendance de l’Algérie, enfermés dans des camps puis bercés d’illusions depuis plus de 4 décennies à coups de compassion, médailles ou autres cérémonies ? Le mépris au pays des droits de l’Homme va-t-il être érigé en Art ? ou bien nos parlementaires pensent-ils toujours comme le Professeur Porot qui justifia l’infériorité des colonisés, en 1918, dans un ouvrage intitulé « Annales médico-psychologiques » : « la vie essentiellement végétative et instinctive
qui est surtout réglée par son diencéphale » ? Il parlait bien sûr des indigènes !
L’Association Harkis et Droits de l’Homme se bat et se battra aussi longtemps que nécessaire pour que la Nation française reconnaisse officiellement sa responsabilité dans le drame des harkis. Un drame qu’il serait injuste et dangereux de sortir de son contexte général de la colonisation.
Aujourd’hui, une ultime loi vient d’être promulguée. Nous pensions que la France avait une occasion historique de réparer ce qui peut l’être encore et que face à la question des harkis, elle allait faire preuve enfin de décence.»
4. Appel du 4 mars 2006
Appel adopté à l'issue du colloque du 4 mars organisé par les associations Harkis et droits de
l’Homme, LDH, Ligue de l'enseignement, Unir, Coup de soleil.
Colloque '1956-2006/50 ans ,les harkis dans l'histoire de la colonisation et ses suites'.
« Ceux qu'on a désignés sous le terme de harkis ne formaient pas un courant politique, ni n'avaient fait un choix idéologique les conduisant à s'engager comme supplétifs de l’armée française. Ils n'ont été ni des militants de l'Algérie française, ni des adversaires de l'indépendance de l'Algérie. Souvent isolés dans leurs campagnes et illettrés, vivant dans le dénuement comme la plupart des paysans algériens, ces hommes se sont retrouvés
plongés dans le plus grand désarroi quand s’est instauré l’état de guerre.
Leur drame est le résultat d'une situation complexe où les deux belligérants ont exercé sur eux des pressions et des violences de toutes sortes pour s’attacher leurs services, ou pour les punir de faits dont on les accusait et que, la plupart du temps, ils n’avaient pas commis.
Au lendemain de l'indépendance, les harkis et leur famille ne représentaient aucun danger pour l'Algérie, et leur vie était censée être protégée par les accords d’Évian cosignés par le jeune État algérien. Pour ces raisons, les crimes commis contre ces personnes désarmées et le comportement des autorités algériennes qui les ont encouragés ou laissé faire constituent des violations fragrantes des droits de l'Homme.
Les harkis et leurs enfants ont payé un lourd tribut à la guerre d’Algérie, non seulement en termes de pertes humaines et de drames familiaux, mais en termes d’exil, et, pour ceux d'entre eux – la grande majorité – qui sont restés en Algérie, d’humiliations permanentes par le pouvoir politique qui les considère encore avec mépris et les prive de leurs droits élémentaires.
La persistance, plus de quarante ans après la fin de la guerre, de ce rejet d'une partie des enfants d'Algérie, les tracasseries dont ils sont aujourd'hui encore l'objet et leur diabolisation quotidienne dans la presse et le discours officiel, allant jusqu'à empêcher que des morts trouvent une sépulture dans la terre de leurs ancêtres, tout cela constitue de graves manquements aux droits de l’Homme auxquels l'Algérie a pourtant souscrits.
Quant aux familles de harkis qui ont pu gagner la France, leur enfermement dans des camps en marge du reste de la société française, leur traitement différent des autres rapatriés, apparaît comme la continuation de leur situation d’indigènes colonisés.
Depuis plus de quarante ans, les harkis, leur femme et leurs enfants vivant en France sont Français et sont souvent victimes de discriminations au même titre que les autres Français issus de l’immigration. Ils veulent vivre comme citoyens français à part entière, dignement, en hommes et en femmes libres dans une société française diversifiée, tout en gardant avec leur pays et leur société d’origine des relations fondées sur le respect et la dignité.
Issus du peuple algérien, ils ont partagé une partie de son histoire et ont encore des attaches très fortes en Algérie qui demeure la terre de leurs origines et de leurs ancêtres. Ils y sont liés, en dépit de toutes les tragédies auxquelles ils ont été mêlés.
A cet effet, ils s’engagent à mener auprès des dirigeants et des sociétés des deux pays les actions nécessaires pour panser les blessures et apaiser les coeurs et les consciences. Ils souhaitent que les autorités françaises reconnaissent la tragédie qu'elles ont fait vivre à ces hommes et leur famille en les abandonnant alors que son devoir était de les mettre à l’abri de vengeances prévisibles étant donné la violence de cette guerre, en les traitant de manière discriminatoire par rapport aux autres Français d'Algérie et en les enfermant dans
des camps dans lesquels ils ont vécu en parias.
Ils souhaitent que les autorités algériennes mettent fin à la diabolisation, aux maltraitances, au mépris et aux condamnations faciles qui ne tiennent pas compte de la situation infernale dans laquelle l’état de guerre avait plongé le peuple algérien. Que le gouvernement algérien exprime ses regrets quant au massacre des harkis. Ils demandent que les harkis et leurs enfants, en raison des attaches familiales très fortes qu’ils ont conservées en Algérie, puissent y revenir, y circuler sans entraves et s’y établir librement.
Et qu'enfin ceux d'entre eux qui le souhaitent puissent trouver une sépulture dans la terre de leurs ancêtres. »
Paris, le 4 mars 2006
5. Après les propos de Monsieur Georges Frêche.
Communiqué de presse
Par Abdelkrim KLECH, Président du Collectif National Justice pour les Harkis -
221, rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil - Tél 06 61 76 40 36 - collectifharkis@yahoo.fr.
« Depuis le 17 février 2006 que le campement est maintenu devant le siège national du parti socialiste au 10 rue de Solferino à Paris, les enfants de harkis déplorent le manque de décision et la lenteur de la mise en place de la sanction à l’encontre de Monsieur Georges Frêche pour ses propos qualifiant les Harkis de « sous-hommes ».
Le PS joue l’horloge et continue à botter en touche
Le Collectif National Justice pour les Harkis regrette que trois mois après ce discours perçu comme raciste, la commission des conflits du parti auquel appartient le président du Conseil régional Languedoc-Roussillon ne s’est toujours pas réunie, et que la date du 19 mai semble dorénavant retenue, sans qu’elle ne soit définitive. Nous espérons que cet organe interne au PS saura prendre des sanctions exemplaires, pour se démarquer enfin de ce discours honteux et incompatible avec les valeurs de notre République.
Le 25 avril dernier, le bureau national de Verts a apporté son soutien aux enfants de Harkis qui mènent cette action devant le siège national du PS : Monsieur Yann Wehrling, Secrétaire National des Verts, s’est personnellement rendu à leurs cotés pour leur témoigner de son soutien et confirmer une nouvelle fois le souhait des Verts de voir Monsieur Georges Frêche sanctionné par son parti.
Une gestion coloniale de la problématique harkie
Depuis notre arrivée en France, les Rapatriés ont fait l’objet d’une politique discriminatoire selon leur origine : alors que ceux de souche européenne étaient gérés par des lois de droit commun bien plus favorables, l’Etat s’est déchargé politiquement de la problématique harkie en confiant son traitement à des organismes privés (Comité Parodi, Cimade ...). Rappelons que cette politique de deux poids, deux mesures reposait sur l’infâme appréciation des pouvoirs publics, considérant les Harkis comme étant « des gens frustres ».
La plupart de nos parents ne savaient ni lire, ni écrire, ni parler le français ; en France, ils ont connu l’enfermement, l’exclusion et le racisme. Les gouvernements successifs ont fait une politique d’exclusion, de mépris et de parcage ; un réel apartheid était mis en place au travers des camps, des hameaux forestiers ou de cités urbaines à la périphérie de villes ; citons à titre d’exemple que nombre d’enfants de Harkis ont suivi une scolarité dans des écoles spécifiques jusqu’à l’âge de 13 ans, loin de l’école de la République. Il en résulte un taux de chômage important, avoisinant les 40 %, un taux de suicide deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les Harkis ne peuvent plus se résigner à un abandon personnel.
Les Harkis sont maintenus dans une position de colonisés, de petits musulmans issus des départements d’Algérie. Cette politique a été menée de manière délibérée et sciemment
par les gouvernements successifs. De manière volontaire, les Harkis ont été empêchés d’évoluer, contraints au renfermement et au repli sur soi. De temps à autre, une mesurette était prise. Tous les partis politiques se sont livrés à un jeu clientéliste, les Harkis étant sollicités lors des élections.
La communauté Harkie s’est mobilisée pour la mise en place d’une loi pour l’équité entre les Rapatriés
La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant « reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » a toujours été rejetée par le Collectif National Justice pour les Harkis. Comment concevoir que les Harkis aient pu adhérer à son article 4, dorénavant abrogé, prônant « la reconnaissance de l’oeuvre positive de la présence française en Algérie » ? La population n’a eu de cesse de vivre
dans un statut d’infériorité ; elle n’a jamais été émancipée ; elle était régie par l’infâme Code de l’Indigénat. La politique menée par la France était de ne pas émanciper la population algérienne, celle-ci a perduré à l’encontre de la communauté Harkie.
La loi du 23 février 2005 a servi à enterrer la question harkie, puisqu’elle se veut être un dispositif valant « solde pour tout compte ». Ce n’est en fait qu’une coquille vide puisque les 30 000 Euros ont remplacé la rente viagère qui existait déjà.
Lors de sa lecture au Parlement, plusieurs propositions d’amendements ont émané des groupes politiques de droite comme de gauche, déplorant que la loi était insuffisante surtout à destination des enfants, des femmes divorcées et des veuves qui n’ont plus rien pour vivre. Le préjudice qu’ont subi notamment les enfants et les réparations ne sont pas concernés par cette loi. Le gouvernement a rejeté les amendements, arguant de
l’insuffisance des lignes budgétaires dont il dispose.
Nous demandons aujourd’hui la mise en place d’une politique plus volontariste à destination des enfants des Harkis : réparation du préjudice moral, mesures en faveur de la formation, de l’emploi, du logement. Egalement en faveur des femmes divorcées et des veuves de Harkis, un dispositif spécifique leur permettant de vivre décemment.
Partie 4
Témoignages et réflexions
1. Le Journal de Mouloud Feraoun. Extraits.
En ouvrant le Journal de Mouloud Feraoun5 à n’importe quelle page, on trouve des récits semblables à ces extraits. A lire lentement ; à la vitesse de leur écriture : au fil des heures, au sein même d’un drame atroce, pour se pénétrer de la terreur, du dégoût, de la désespérance d’un homme constatant l’inhumanité profonde d’une guerre dont il avait pourtant espéré l’issue heureuse pour son peuple. Pour n’importe lequel de ces écrits, Mouloud Feraoun aurait pu risquer la mort, quel que soit le camp de ses hypothétiques lecteurs. Il le savait,
écrivait sur un cahier d’écolier qu’il cachait parmi ceux de ses élèves.
Ceux qui l’ont tué, ceux qui regrettent peut-être de ne pas l’avoir fait ne pouvaient pas l’avoir lu. Ils y auraient trouvé leur justification. On peut jurer qu ils ne s’y sont pas risqués depuis, de peur de perdre leurs raisons, ou peut-être même leur raison. Cela vaut certainement mieux pour leur tranquillité.
Ceux qui n’ont pas vécu ces situations avec la même sensation de vulnérabilité extrême, où la mort peut venir à tout moment de partout y compris de ses protecteurs, y trouveront peut-être de quoi comprendre ce qu’est un réflexe de survie où le choix d’un abri –fut-il chez l’adversaire- peut être dicté par l’instinct vital bien davantage que le choix volontaire d’un parti.
27 mai 1956 (p. 124)
« Les villages A.-A. et T ont été encerclés dans la nuit du dimanche, il y a juste une semaine. Les soldats arrivés dans la nuit sur la place de la mairie vers dix heures sont descendus vers ces villages vers une heure. Les exécutions (deux à T. et une à A.-A.) ont eu lieu au petit matin. L’officier avait une liste. Il s’est fait indiquer les demeures des suspects. La plupart avaient pu s’enfuir. Ceux qu’on a découverts ont été sortis de leur lit brutalement puis mitraillés sans doute après interrogatoire classique.
Vers huit heures le même officier signale à Dj., chef du village, que les soldats avaient tiré sur deux suspects qui tentaient de fuir. Il lui demandait de venir reconnaître les cadavres.
C’étaient ceux de ses propres enfants et l’officier venait de prendre, chez lui, le café matinal que les règles de l’hospitalité offrent à l’étranger de passage. Dj. savait que ses enfants avaient été arrachés de leur lit. Il savait aussi qu’ils étaient suspects. Il acceptait qu’ils fussent arrêtés, emprisonnés, condamnés. Il les croyait entre les mains de la justice et cela le rassurait : ils étaient, l’un et l’autre, dans des fossés, en bordure de la route, déchiquetés par les balles et méconnaissables. »
8 octobre 1956 (p.152
)
« …Dans ce village kabyle, de jeunes inconscients vous racontent la mort du gros Hocine :
- Vous savez il est lourd, le bonhomme. On a voulu le pendre. Il a emporté la branche d’olivier. On aurait dit que l’arbre dégringolait tout entier. Non, c’était lui. Comme un sac de fumier, il a roulé jusqu’au ravin et là on l’a achevé à coups de pelle car il n’était pas mort en tombant ; dès le premier coup : boum, la tête a éclaté comme une pastèque… on lui a jeté un peu de terre. Lorsque nous sommes revenus au village, les maquisards se partageaient du pain et du foie de veau grillé. Mon camarade n’a pas voulu en prendre : il faisait le dégoûté. »
14 octobre 1956 (p.153-154)
« Les femmes savent d’expérience qu’il ne faut pas parler à la légère. Le tarif d’un jugement est exorbitant pour les pauvresses. Un jugement sévère ou sceptique, une parole qui échappe, une interjection et l’amende vous tombe dessus.
- Ah ! tiens, tu n’es pas contente, toi ? Alors ceux qui se battent et meurent n’ont pas droit à ta reconnaissance muette ? Cinq mille ou on t’étrangle. Un bout de corde, ma vieille. Compris ?
Elle a compris mais elle se lamente, se débat, implore et finit par lâcher cinq mille francs en se promettant bien de se taire désormais. Yamina s’en allant à la source bute contre une pierre et peste contre les temps. Son orteil est ensanglanté. Un patriote surgit devant elle, la prend par la gorge et lui fait la leçon :
- De quoi ? Tu pestes contre l’an de grâce 1956, l’année de notre lutte victorieuse, de ta libération, chienne ! Tu jures au lieu de te réjouir ! Cinq mille francs. A déposer chez Kaci… Je passerai ce soir. Attention, je te connais.
Fatima, un beau matin, trouve des militaires à l’entrée du village.
- Bonjour sur vous, dit-elle « Bonjour » en français « sur vous » en kabyle. Un fellagha l’empoigne.
- Vieille charogne, tu ne peux pas parler kabyle ?
- Bonjour sur vous, mes enfants, Dieu vous aide, vous protège, vous…Le tout en bon kabyle cette fois.
- Suffit. Dix mille francs.
- Je vous prenais pour des Français.
- Vingt mille ! Dans ce cas, une patriote détourne les yeux, crache par terre et passe sans rien dire. Toi, tu mériterais la corde. Vingt mille. A déposer chez Kaci. Et que Satan t’emporte.
J’ai connu Belkacem et Hocine quand j’exerçais chez eux. Hocine a été pendu. Savoir pourquoi. Belkacem est allé s’installer au cantonnement militaire avec les siens après une bagarre au cours de laquelle il a été roué de coups. Il a raconté aux militaires tout ce qu’il savait sur les activités rebelles dans son village. Un ratissage audit lieu n’a rien donné. Mais quelques jours plus tard, Belkacem a mystérieusement disparu : il n’est plus chez les militaires, il n’est plus au village. Aux dernières nouvelles sa femme et ses enfants auraient réintégré leur habitation. Les patriotes ont exécuté la belle soeur de Hocine pour avoir mal parlé d’eux et la soeur de Belkacem pour avoir pleuré son frère. Toutes deux sont mères de famille. »
29 novembre 1956 (p. 170)
« …Les maquisards ripostent à ces mesures restrictives : ils déchirent les laissez-passerdifficilement délivrés, ils achèvent de vider la ville où jusqu’ici on laissait filtrersoigneusement les gens des villages ; en un sens ils finissent le travail du gendarme et dumilitaire. Dans un proche avenir, on fera perdre au Beni Ratem l’habitude de venir à Fort-National, l’habitude et le goût et lorsqu’on ouvrira toutes grandes les portes pour les recevoir,
personne ne se présentera à l’entrée… Avant-hier a été exécuté le gros Lamara. Il y a longtemps que la chose l’attendait mais on le croyait assagi, rangé, immobile. Qui sait, il a peut-être voulu bouger.
A chaque exécution de traître ou de prétendu tel, l’angoisse s’empare des survivants. Personne n’est sûr de quoi que ce soit, c’est véritablement la terreur. Terreur du soldat, terreur des horsla- loi. Terreur qui plane mystérieuse et inexplicable. Les nerfs sont à bout… »
8 janvier 1957 (p.184)
« Mon collègue B. qui est rentré de chez lui m’apporte des renseignements sur ce qui s’y passe. Il a l’habitude d’exagérer, le collègue. Mais à travers ses exagérations mêmes, il reste vrai, indiscutable que des crimes affreux et des viols systématiques se sont consommés aux Ouadhias. Les soldats ont eu quartier libre pour souiller, tuer et brûler. Les maquisards de leur côté ont cru bon d’accabler la population et de la terroriser pour éviter qu’elle ne se rallie. C’est à qui se montrera le plus cruel, du fellagha ou du soldat…. Quelle que soit l’issue de la lutte, il ne sera pas aisé de reconstruire.
Après la mort du lieutenant Jacote m’a dit Bedd., le douar a été ratissé. Le premier village fut carrément vidé de ses habitants. Dans les autres villages, on a cueilli tous les hommes. Les hommes ont été enfermés tous ensemble pendant quinze jours. On en a tué environ quatrevingts, fusillés par petits paquets chaque soir. On faisait préparer les tombes à l’avance. Par ailleurs, après ces quinze jours on a constaté que plus de cent autres avaient disparu. On suppose qu’ils ont été enfermés dans des gourbis pleins de paille et brûlés. Aucun gourbi,
aucune meule ne subsiste dans les champs. Les femmes sont restées dans les villages, chez elles. Ordre leur fut donné de laisser les portes ouvertes et de séjourner isolément dans les différentes pièces de chaque maison. Le douar fut donc transformé en un populeux B.M.C. où furent lâchées les compagnies de chasseurs alpins ou autres légionnaires. Cent cinquante jeunes filles purent trouver refuge chez les Soeurs ou chez les Pères Blancs… On ne découvre aucune trace de quelques autres. »
24 janvier 1957 (p. 191)
« Le jeune Rezki est venu me voir dans mon bureau. Il m’a dit que son père a été tué par d’anciens élèves qu’il a reconnus. Des gens du village qui s’étaient masqués mais qu’il a toutde même reconnus. L’un d’eux a même laissé tomber le foulard qui lui cachait la figure : il était pâle parce qu’il venait de rater son vieux maître. Celui-ci est parti en courant à travers champs et les autres l’ont suivi. Bientôt le fils et la mère ont perdu de vue le fuyard et ses poursuivants. Ils sont montés au village en criant et ont alerté la troupe. Le corps n’a été retrouvé que quarante huit heures après dans le ruisseau : il avait une balle au front, d’autres
dans le dos.
J’ai laissé parler le jeune homme. On reproche à son père de trop fréquenter les militaires. J’ai compris qu’on le soupçonnait aussi d’avoir donné des renseignements. Les maquisards ont peut-être des preuves. Il y a aussi des dessous, des histoires de village, avec les anciennes rancunes, les jalousies, prétend le gosse. Mais est-ce que les maquisards font bon marché de la vie d’un homme au point de la condamner à la légère ? est-ce qu’un maquisard quelconque, fût-il un bandit, peut prendre sur lui-même d’abattre quelqu’un qui ne lui plaît pas ?… »
3 mars 1957 (p. 209)
« … En attendant, dans les villages, les gens commencent à s’en lasser. On leur demande de l’argent, ils ne savent d’où le tirer, ils sont tenus d’héberger les maquisards et de leur servir bonne chère, il faut qu’ils rompent tout contact avec les Français et qu’ils se débrouillent tout de même à ne manquer de rien. Il faut qu’ils se mettent tous hors-la-loi et qu’ils n’obéissent plus –mais aveuglément- qu’aux hors-la-loi. Les responsables des villages suscitent la crainte et l’admiration. Ils sont bien habillés, gros et gras et arrogants. Ils se sont déjà installés au pouvoir. Ils sont désormais indépendants. Mais restent tous les autres qui crèvent de faim, de
terreur et de haine rentrée. Un jour ça ira mal pour les indépendants. »
Mouloud Feraoun Journal 1955-1962 Editions du Seuil.1962
2. Kristel sous les harkis
Bernard Zimmermann, Soleil en Essonne
D’après un entretien avec Nouba Hadj Abed, d’une vieille famille de Kriste, mars 2006.
En 1956, la "guerre d'Algérie" dure depuis deux ans. Le village de jardiniers et de pêcheurs de Kristel, à dix-huit kilomètres d'Oran, sur la côte Est de la baie, est presque totalement habité par une population algérienne ; il vit sous le triple contrôle et la triple menace des colons, de l'armée et de ses supplétifs harkis. Les colons sont des Européens du chef-lieu de la commune, Saint-Cloud, situé à une dizaine de kilomètres de Kristel, et dont dépend le village algérien ; leur pouvoir est relayé sur place par deux gardes. Le Commandant P., de la place
d'Oran, tient en main les harkis.
Les deux gardes sont le vieux Mouloud et Kader, tous les deux originaires de Kristel. Mouloud est en charge de la surveillance de la forêt, Kader de celle de la population. Le contexte de peur et de violence de la guerre a permis aux gardes d'accaparer des biens par la contrainte : Mouloud a mis la main sur le café de la Source, en dépossédant ses propriétaires, et il en a confié la gestion à son fils ; Kader contrôle la madrague qui rapporte beaucoup à la saison du passage des bancs de bonites.
C'est Nouba qui témoigne de cette histoire ; il est d’une famille de caïds du village, vieille représentante du pouvoir local depuis toujours, mais depuis la conquête démise de cette autorité pour n'avoir pas pactisé avec le colonisateur. Selon Nouba, le vieux garde Mouloud était plus "souple" que son collègue Kader ; il n'a pas fait grand mal sauf au père-aubergiste de l'Auberge de Jeunesse de Kristel, Barbéris. Nouba rapporte que ce dernier était communiste ; pour cette raison, les colons de Saint-Cloud auraient commandité son exécution
et confié l'organisation de son assassinat à Mouloud. Ce dernier embaucha un commando de tueurs qui se rendirent chez Barbéris. Celui-ci les accueillit dans son auberge, leur offrant à boire cordialement. Touchés sans doute par cette hospitalité, les hommes avouèrent à Barbéris la raison de leur venue. Ils montèrent un scénario destiné à faire croire à Mouloud qu'ils avaient exécuté leur mission, Mouloud en informa les colons. Et tandis que Barbéris disparaissait de Kristel quelque temps, les "tueurs" empochèrent l'argent des commanditaires
et disparurent dans la nature.
De son côté, sous l'égide du commandant P., Kader a pris la direction de la harka de Kristel. A Kristel, tout le monde est plus ou moins "cousin" ; par exemple, Kader est un "cousin" de Nouba. Kader a constitué sa harka avec des hommes du village, en premier ses propres "cousins" ; ce sont de pauvres gens sans ressources, qui trouvent dans cet enrôlement un petit moyen de subsistance immédiate (ils sont nourris et logés par Kader) ; mais certains ont aussi obéi sous des menaces de mort (des hommes commencent à disparaître alors) ou à cause de
chantage du genre : "si tu ne viens pas je baise ta femme". Les harkis ont pour principale occupation de protéger nuit et jour la maison de Kader ; celle-ci est flanquée par des miradors, éclairée par des projecteurs, la nuit. Autrement, les harkis font du ramassage de bois dans le djebel et, bien sûr, ils surveillent le village. Un jour, ils descendent jusqu'au cabanon de Nouba, prétextent qu'ils ont entendu un coup de feu par là, et saccagent la maison.
Au village, les gens en veulent à mort à Kader, aussi ce dernier ne se sépare jamais de sa mitraillette qu'il porte en sautoir, même lorsqu'il participe à des partis de pêche avec des hommes de Kristel. Le village n'a jamais connu d'attentats mais des collectes de fonds ontlieu, comme ailleurs ; des membres du FLN passent parfois la nuit. Ils ont pris contatc avec Kader, le mettant en garde à cause de ses agissements, mais ils n'ont jamais rien tenté contre lui afin de ne pas faire courir au village le risque de représailles.
Pourtant, ceci arrive en 1956. A l'été de cette année-là, un mitraillage du cinéma de Saint-Cloud, tenu par un Européen, Renaud, a eu lieu. Une voiture est passée, dont les occupants ont mitraillé la façade du
cinéma, sans qu'il n'y ait eu de victimes. Aussitôt, les représailles sont engagées ; elles mobilisent les fils de colons de Saint-Cloud, l'armée et les harkis. Ils descendent à Kristel, le village est encerclé par l'armée. C'est Kader qui choisit des jeunes gens du village et les désigne comme des gens du FLN aux militaires. Dix-sept hommes sont battus devant la population, embarqués dans des camions, montés au-dessus du village où, sur la route de Saint-Cloud, se trouve une décharge. Là, ils sont abattus par les soldats. Le commandement militaire a interdit aux gens du village de venir ramasser les corps avant 48 heures. Les cadavres sont donc restés, en plein été, deux jours exposés au bord de la route.
Que sont devenus les protagonistes de cette histoire ?
Les Kristelliens ont payé un prix fort à la guerre. Bien que nulle violence n'ait été commise de leur part au village ni dans le coin, plusieurs hommes ont été tués ou ont disparu durant le conflit, en dehors de l'affaire de l'été 1956. Un homme a été jeté sur la Montagne des Lions du haut d'un hélicoptère.
Les gens du village n'ont pas exercé de représailles contre les harkis, au moment de l'indépendance. D'après Nouba, ils considéraient que ceux-ci n'étaient que de pauvres diables sans responsabilité majeures. Par contre, leur chef, Kader, ainsi que son frère, furent expatriés à temps par le commandant P.. Kader se retrouva à Toulouse, où il semble qu'il se soit établi ; il eut un enfant qu'il prénomma "Ben Bella", mais ceci est peut-être une histoire apocryphe, bien que Nouba en assure l'authenticité. La madrague revint à une coopérative de pêcheurs et le café de la Source à ses anciens propriétaires il n'existe plus aujourd'hui.
3. Des almogatazes aux harkis.
Situations comparées des habitants de la région d'Oran à l'époque de l'occupation
espagnole et sous la domination française.
Bernard Zimmermann, mars 2006
Durant la guerre d'Algérie, en 1956, un épisode tragique marqua l'existence du village côtier de Kristel, près d'Oran. En représailles à un mitraillage par des terroristes du cinéma du cheflieu voisin (attentat sans victimes), l'armée investit Kristel. Les terroristes n'avaient pas été identifiés mais, sur désignation du chef des harkis locaux, dix-sept hommes furent saisis, battus puis emmenés et abattus sur la route par les militaires français. Le chef des harkis, un nommé Kader, était placé sous l'égide d'un officier français de la place d'Oran ; il agissait en petit despote ; c'est par des menaces, et en conférant quelques menus avantages matériels, qu'il avait embrigadé une poignée de jeunes hommes du village dans sa harka. Leur principale tâche consistait à veiller à la sécurité de la maison de Kader. A l'approche du jour de l'indépendance, ce dernier et son frère purent passer en France grâce à l'intervention de l'officier d'Oran dont ils dépendaient. Les jeunes harkis restés à Kristel ne subirent pas de mauvais traitements ; les gens du village les considéraient comme de pauvres diables qui n'avaient pas été responsables des exactions commises par leur chef. Cette sagesse dut peutêtre quelque chose à l'emprise morale sur les esprits du responsable politique local du Front de Libération, un homme intègre et d'un jugement mesuré. Le moment de l'indépendance venu, il s'effaça pour se consacrer uniquement à ses activités professionnelles.
L'histoire des habitants de Kristel dans les dernières années de la domination française, soumis à la surveillance directe des harkis pendant cette période de conflit, renvoie en écho à une histoire plus ancienne, à laquelle on ne peut s'empêcher de songer, et dont leurs ancêtres furent des protagonistes. Il s'agit de ce que fut la relation entre la tribu de Krichtel (encore appelée de "Canastel") avec les Espagnols du presidio d'Oran, tout au long des deux siècles de la première occupation espagnole de cette place-forte, c'est-à-dire aux 16ème et 17ème siècles. La comparaison a ses limites mais elle ne manque pas non plus de nous inviter à des réflexions susceptibles de nuancer nos jugements, dès lors que la question des harkis est évoquée.
Les écrits des chroniqueurs, aussi bien arabes qu'espagnols, rapportés notamment par Paul Ruff sur lequel on peut s'appuyer, permettent de caractériser la situation particulière des tribus situées dans l'orbite d'Oran, à partir du début du 16ème siècle, comme une situation de piège ; les populations locales sont prises entre les feux croisés des Espagnols, d'un côté, et des Turcs, venant de l'Est. Deux puissances visent à contrôler politiquement et militairement, prennent en otage, punissent à l'occasion, les habitants de la région d'Oran.
Les Espagnols ont appelés "Moros de paz", "Maures de paix", les populations directement soumises à leur influence. Paul Ruff indique qu'elles occupaient un territoire n'allant pas audelà d'une distance de deux journées de marche, pouvant être couverte sans nécessiter les contraintes d'une "expédition" ; cette zone s'étendait "jusqu'aux montagnes voisines de Kristel". Sidi Abdelkader el Mecherfi nous dit que la tribu de Kristel ravitaillait la "place aux herbes" d'Oran. Ce fut-là une de ses principales fonctions aux yeux des Espagnols, dont Ruff nous apprend que l'approvisionnement représenta un problème permanent pour eux, tout au long de leur occupation. Les Moros de paz étaient soumis au paiement d'un impôt, c'étaient des tributaires, restant secrètement hostiles aux Espagnols et dont ces derniers devaient se
méfier sans cesse. Ruff souligne qu'il n'y eut "jamais de sécurité dans la région la plus proche de la ville".
La question sécuritaire pèse pendant deux siècles sur les gens de la région.
Voici comment Ruff décrit l'état général des rapports entre les "indigènes" et les Espagnols. "Le fanatisme religieux qui animait également les Espagnols et les indigènes n'était-il pas un obstacle insurmontable (à l'idée du Comte d'Alcaudete de former un vaste "royaume arabe", vassal de la couronne d'Espagne, ndlr) ? Il ne faut pas oublier que l'entreprise d'Oran conserva toujours le caractère d'une entreprise religieuse, d'une sorte de croisade permanente. D'autre part, les musulmans ne pouvaient oublier la conduite des Espagnols à l'égard de leurs coreligionnaires d'Espagne et la présence de Maures andalous parmi eux devait encore exciter leur défiance et leur haine de l'infidèle. Dans de telles conditions l'accord ne pouvait être ni solide ni durable."
Les dernières considérations semblent tout particulièrement adaptées aux habitants de Kristel, dont l'origine berbéro-andalouse semble possible, et qui, en 1960 encore, traitaient une personne de "Spagnouli" lorsqu'ils voulaient marquer leur mépris et leur hostilité. (C'était le cas à l'encontre des Pieds-Noirs).
Les Espagnols eurent recours à l'enrôlement de supplétifs indigènes pour conforter leurs propres forces, et ceci pendant deux siècles. Les rivalités entre les tribus et les grandes familles féodales, facilitait cette tâche. Ruff cite, par exemple, la tribu des Beni-Amer, à proximité d'Oran, devenue "de très bonne heure l'alliée des Espagnols", et dont le concours fut "fort utile". Ruff, toujours, évoque la présence dans Oran, d'une "troupe de Maures réfugiés, les almogatazes, véritables renégats politiques qui étaient à la solde du gouvernement et laissaient dans la ville leurs familles qui servaient d'otages" ; en note, il cite Fey, historien d'Oran, qui "considère ces almogatazes comme formant un corps de troupes indigènes analogues à nos spahis." (souligné par B.Z.).
Les Espagnols étaient bien conscients que la sujétion des Moros de paz ne tenait qu'autant qu'ils étaient en mesure de leur imposer leur force. Aussi, est-il nécessaire de parler maintenant des razzias, ce que les Espagnols dénommaient la "guerra ordinaria", "la guerre ordinaire". Ruff indique clairement de quoi il s'agit :
"(…) le moindre prétexte suffisait pour qu'on allât razzier les tribus voisines. Le simple soupçon que les Maures soumis avaient pu s'entendre avec les ennemis, Arabes ou Turcs, provoquait de rigoureuses répressions, et l'on ramenait de ces expéditions généralement aussi fructueuses que peu périlleuses des prisonniers et du bétail."
Voici la description d'une de ces razzias, elle concerne précisément la tribu de Canastel, c'està- dire de Kristel.
"(…) le capitaine-général (le Comte d'Alcaudete, ndlr)… prit les mille soldats qu'il amenait (d'Espagne), leur adjoignit cent cinquante cavaliers et six cents fantassins de la garnison, et marcha contre le village de Canastel (Kristel, ndlr). Il voulait punir les habitants qui avaient reçu des armes pour se défendre contre les Turcs et qui, tout au contraire, les avaient bien accueillis et leur avaient livré les armes. On en prit deux cents et l'on en pendit trois des principaux."
Cette affaire se déroula, selon le chroniqueur Marmol, en 1556, et fut une répétition d'événements semblables survenus en 1545…
On pourrait en déduire que les "indigènes" étaient donc les alliés naturels des Turcs, étant de surcroît de même religion. Mais les choses n'étaient pas si simples.
Cervantes mena une mission à Oran, en mai et juin 1551, pour le compte de Philippe II, roi d'Espagne. Il décrit ainsi les rapports entre les Turcs et les Maures, propos rapportés par Emmanuel Roblès dans la Revue oranaise Simoun (1958), consacrée à Cervantès à Oran :
"Es commun y casi natural el miedo que los Moros a los Turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes, y tienen tanto imperio sobre los Moros que a ellos estan sujetos, que les tratan peor que si fueran esclavos suyos." (La crainte que les Maures ont des Turcs est commune et comme naturelle, surtout vis à vis des soldats, lesquels sont si méprisants et exercent tant de contrainte sur les Maures qui leur sont assujetis, qu'ils les traitent de pire façon que s'ils étaient leurs esclaves.)
Le chroniqueur Baltazar de Morales, cité par Ruff, évoque aussi la méfiance des Turcs vis à vis des Maures, par exemple lors du siège d'Oran, en 1556, qui se termina par le retrait des Turcs. Il est vrai que le Comte d'Alcaudete eut recours à une ruse pour brouiller Turcs et Maures.
"Il écrivit et s'arrangea pour laisser prendre une lettre dans laquelle il rappelait aux Maures leurs promesses de fidélité et les convoquait pour le jour prochain d'une sortie. Les Turcs auraient dès lors témoigné une grande défiance à l'égard des Arabes?"
Pour quelles raisons,après tout, ce genre de procédé serait-il l'apanage d'un seul temps et d'une seule histoire ?
Lorsque les Espagnols furent évincés d'Oran, à l'issue de leur première période d'occupation, en 1708, les Turcs occupèrent le terrain évacué. Le "Rapport de la Commission d'enquête du territoire de Krichtel", établi par les Français en 1873, comporte un passage décrivant ce qu'il advint alors de la tribu de Kristel. Dans sa partie historique il est dit qu'entre 1708 et 1737 il y eut conflit entre la tribu et le Bey Bou Chelagram. Ce dernier reprochait à ses membres d'avoir fait cause commune avec les Espagnols (et aussi de ne pas payer l'impôt). Défaits, les gens de Kristel furent expulsés de leur territoire par les Turcs, et dispersés dans la région de
Mascara et à Mazagran, près de Mostaganem. Ce n'est qu'en 1770 que leurs descendants se réapproprièrent leurs terres, par rachat auprès du Bey Mohamed, pour un montant de 1000 dinars en or. Cet épisode me fut rapporté d'un autre côté par Abdelkader K., instituteur de l'école française, issu d'une des grandes familles de la tribu de Kristel. Il reste une trace de cette déportation, c'est l'existence de jardins, à Mazagran, dont l'étendue, l'organisation hydraulique et la gestion à la mode de la huerta de Valence (ou ce qu'il en restait dans les années 60 au moins) étaient entièrement calquées sur celle des jardins de Kristel.
De la tribu de Kristel sous la domination du Comte d'Alcaudete à leurs descendants sous la domination française en Algérie, des almogatazes de l'Oran du 16ème siècle aux "supplétifs musulmans" de l'armée française de la guerre d'Algérie, d'étroites similitudes de conditions, de situation, apparaissent donc. Les populations prises dans des enjeux qui les dépassaient, sommées de façons contraires d'obéir et de servir, de s'exécuter ou d'être exécutées, avaient-elles quelque choix ? L’historien a pour fonction de mettre à jour ce qui s’est réellement passé, il n’a pas à juger. Les citoyens qui ne sont pas historiens, comme nous, sont tenus à la même équité.
Références.
- Paul Ruff, La domination espagnole à Oran sous le gouvernement du comte d'Alcaudete, 1534-1558, Editions Bouchene, 1998.
- Sidi Abdelkader el Mecherfi, L'agrément du lecteur, cité dans la Revue Africaine, 2ème semestre 1924.
- Miguel de Cervantès, L'Espagnol courageux, Revue Simoun, numéro 28-29, Oran, 1958.
- Exécution de la loi du 26 juillet 1873 sur la propriété individuelle. Commission d'enquête du territoire de Krichtel. Rapport d'ensemble. 1873.
- Cartes au 1/50 000 de la région d'Oran.
4. Harkis : volontaires ou « malgré nous » ? » Mémoires croisées.
Michel Laxenaire.
Heureux hasard pour moi : Fatima Besnaci est originaire de Novi où j’ai eu des amis. Jacques Roseau en était originaire ; il était membre d’une famille que nous connaissons fort bien (dans laquelle Marie Jo ma femme a toujours des amies intimes). Son livre « Le 13e convoi » en raconte la saga. De plus, Novi se trouve au pied du massif du Dahra, où notre ami Saïd (Louis Kergoat), alors petit frère dans la Fraternité De Foucauld a vécu la
tranche de vie qu’il relate dans son livre « Frères contemplatifs en zones de combat », etc. Un lieu, un massif, des habitants que je n’ai aucune peine à me représenter.
Lorsque nous avons écrit notre livre, Bernard Zimmermann et moi (Retours de mémoires sur l’Algérie), j’ai eu l’occasion de lui parler de cette bande littorale de petits colons où se vivait une sorte de relation apaisée entre les différentes communautés, dont le souvenir était encore perceptible après l’indépendance. Harmonie antérieure à la conquête puisqu’on vénère dans ces environs de Ténès la mémoire de Yemma B’Net, la plus célèbre des cinq rescapées du naufrage d’un navire napoléonien en 1802 et du massacre qui avait suivi, guérisseuse pour les uns, mère religieuse pour d’autres, « accueillie » par les Beni Haoua, les voisins de Saïd.
Au départ, dans cette population que je connaissais, l’écart des points de vue ne devait pas être bien grand entre la famille de Fatima qui était du village (où Fatima allait à l’école) et les paysans des gourbis de montagne. Pour les uns, la présence française n’était pas qu’oppressante ; les autres s’en accommodaient plus ou moins. Pour ceux « d’en bas », la présence d’une population européenne était familière, des relations personnelles pouvaient
exister et des services se rendaient ; dans un mélange de français et d’arabo-berbère, la communication était possible ; des familles vivaient même en proximité sur les petites exploitations ; sans être généralisées, des amitiés d’enfance se nouaient dans les jeux. Quant à ceux du djebel, ils se déplaçaient régulièrement pour les marchés, plus rarement pour d’autres raisons, mais fournissaient la main d’oeuvre saisonnière, notamment pour les vendanges. Pour les hommes au moins, le contact avec les Européens n’était pas exceptionnel. En comparant
leurs chemins muletiers et leurs gourbis sans confort par comparaison au village, ceux-là pouvaient néanmoins souffrir davantage de leur condition défavorisée.
Vue de ces régions, la rébellion semblait se dérouler dans une autre planète (en 1956, j’y ai organisé un camp scout sans aucune appréhension). Ses échos s’y faisaient évidemment entendre, mais parvenaient comme assourdis. La population espérait bien qu’une issue favorable soit rapidement trouvée et vivait dans cette attente. D’ailleurs, la rébellion a mis du temps à s’implanter dans la région, plus exactement à faire parler d’elle. Ses premières manifestations ont été volontairement voyantes comme pour dire « nous sommes là » : poteaux sciés, routes coupées, agressions de la force publique… mais se cantonnaient au domaine « militaire ». D’une certaine façon, les civils pouvaient avoir des opinions divergentes vis à vis de l’avenir de l’Algérie. Etre favorable à un statut-quo amélioré ne s’apparentait pas à une trahison impardonnable.
Les cadres du maquis qui se formait dans le Bissa sont venus « de l’extérieur ». Leur activité première fut de se faire accepter par la population locale et d’y faire de la propagande et du recrutement. Agissant par persuasion et refreinant les tentations de quelques-uns, ils faisaient régner une discipline librement acceptée. Nul ne contestait leur autorité. Les pages écrites par Saïd au moment où s’installait le maquis témoignent de leur grande humanité autant que de leur maturité politique.
Apprenant à les connaître et se faisant reconnaître lui-même pour ce qu’il était, Saïd s’était lié d’amitié avec les responsables. Il a gardé une grande admiration pour Si M’Hamed, commandant de la Wilaya IV et son adjoint Si Lakhdar Boudjemaa.
A l’image de la population locale, ces hommes étaient impatients de hâter la paix. On comprend que des gens comme eux aient pu répondre à l’orchestration des fraternisations du 13 mai en croyant à la réconciliation des communautés. Que des hommes y aient succombé ou que ces démonstrations largement médiatisées les y aient préparés, il est tout a fait compréhensible que des ralliements volontaires aient pu être envisagés dès ce moment. Forts de la confiance des populations de la Wilaya IV et d’une attente qui leur semblait largement partagée, les officiers du Bissa ont cru pouvoir prendre l’initiative de répondre à l’offre de « paix des braves » du général de Gaulle. Naïvement, ils ont cru à la sincérité de sa proposition et ont tenté –en vain- de le rencontrer à Paris. On les a exécutés à leur retour au maquis.
A travers les silences douloureux de Saïd sur ces faits, j’ai cru comprendre que leurs compagnons exécuteurs n’ont pas agi que sur ordre. L’occasion leur était fournie de prendre une place convoitée et de donner libre cours à leur fureur guerrière. A partir de ce moment, le maquis du Bissa a changé d’atmosphère. Il devait peu à peu ressembler à ce qu’en dit Fatima. Deux de nos chers amis de Novi en ont été les premières victimes.
Se rallier ou mourir
En aidant Saïd à écrire son livre, et puisant dans mes souvenirs, j’ai pu imaginer comment, tout en évoluant dans le même sens, l’écart s’est creusé davantage entre ceux du village et ceux du djebel. Lorsque l’armée, qui ne savait et pouvait faire qu’une guerre classique a décrété que le Bissa était zone interdite, elle a enfin pu utiliser ses moyens et bombarder la montagne sans ménagement. Les populations de la montagne n’avaient alors pas d’autre solution que la soumission ou la mort.
On a peine à intérioriser ce que peut être la terreur d’une population vulnérable et agressée sur laquelle la mort tombe à tous moments.
Je l’ai vécu lorsque j’allais à Hanoteau –autre village du massif- où, depuis l’esplanade jouxtant la SAS, un canon tirait en direction de la « zone interdite ». Avec notre ami lieutenant de cette SAS, je suis allé en convoi de deux véhicules dans cette zone interdite porter le courrier et le ravitaillement à une section isolée sur son piton. Je me souviens de la peur qui nous taraudait les tripes lorsque, sur la piste, nous tentions de déceler à l’oeil nu ce qui aurait pu nous annoncer l’enfouissement d’une mine. Je me souviens aussi de l’arrêt brutal
du half track qui nous devançait, lorsque son guetteur croyait avoir vu une silhouette se cacher derrière un buisson de figuiers de Barbarie, puis du tir sur ce buisson à la mitrailleuse lourde (12.7 pour les initiés) et des ses balles traçantes. Je me souviens avoir prié pour que la cible ne soit pas un petit berger ; heureusement, ce n’était que le fantôme de notre peur commune. Je me souviens de ce piton surplombant, surveillant aussi un malheureux village de regroupement, avec sa harka pitoyable armée de fusils de chasse qui se rassemblait
spontanément comme si notre visite annonçait une issue, et ses appelés errants ayant perdu
l’envie de communiquer, voisins forcés attendant un terme, quille, indépendance ?
A côté de ce canon, la SAS était surréaliste. Notre couple d’amis de Hanoteau s’y étaient investis avec générosité. En dehors des fils de gendarmes, la femme du lieutenant n’avait que les petits montagnards comme élèves ; les gendarmes s’offusquaient d’ailleurs qu’ils arrivent aux premières places. Cette image était bien représentative de l’idée véhiculée par la propagande officielle. La réalité était autre. Peu à peu se déchaînaient les semeurs de sauvagerie, la mort ne suffisant plus, c’est à qui se surpassait dans l’horreur. Les malheureux indécis en étaient toujours la cible. C’est ainsi que de plus en plus de blédards ont été contraints de se choisir un abri plutôt qu’un parti, souvent de façon précipitée sous la menace imminente.
Je suis de ceux qui, tout en ayant approché la réalité ne l’ont pas vue parce qu’elle «était invraisemblable. Parce que je ne pouvais pas imaginer que nous étions capables de faire à notre tour des « Oradour ». Parce que je n’ai pas entendu près de moi les femmes, les enfants hurler d’une peur atroce, réfugiés à l’abri illusoire d’un mur de torchis. Parce que je n’étais pas à côté de ceux qui craignaient les nuits, et ces bruits de pas qui n’annonçaient jamais le parti de ceux qui approchaient.
Il faut lire et relire le Journal de Mouloud Feraoun pour le vivre avec lui. Lire l’horreur pour s’en faire une idée.
Je me souviens que, lorsque je suis retourné à Novi après l’indépendance pour m’informer de l’autogestion qui y avait été instituée, sans faire allusion à mes anciennes amitiés, les fellahs que je rencontrais profitaient de l’intimité de nos rencontres pour me dire ce qu’ils avaient sur le coeur. Dès l’indépendance, les djounoud s’étaient emparés de tous les biens abandonnés par les européens : habitations, voitures, meubles et bien entendu, caves. Ils étaient armés et les fellahs (qui n’avaient même pas de poudre pour chasser les sangliers qui pullulaient dans la région) disaient « que veux-tu que nous fassions ? Heureusement qu’avec les voitures et le vin
ils s’éliminent tout seuls.» Dans la montagne, un djoundi avait pris l’initiative de lancer immédiatement une école parce qu’il donnait la priorité absolue à l’instruction ; celui-ci était bien de la race des purs que Saïd a connus, mais au village, les prédateurs s’étaient rabattus pour la curée. Alors, ceux qui se confiaient à moi étaient-ils des collabos ? des nostalgiques de la présence française ?
Nul ne pourra jamais dire quelles proportions de harkis ont librement choisi le « parti de la France », l’ont fait sous la contrainte de nos armes, ou ont sauvé leur peau devant les enragés du terrorisme. Mais les présenter systématiquement comme des alliés patriotes ou des collabos est une falsification de l’histoire.
Je comprends que ceux qui ont sauvé leur peau, trop souvent en laissant à leur sort le reste de leur famille n’ont pas eu le coeur de s’en glorifier. Chacun ayant ses raisons de laisser entendre que les ralliements relevaient d’un choix volontaire, la légende des harkis unanimement partisans de l’Algérie française a pu se répandre sans contradictions.
5. Témoignage d'un appelé.
D’après le témoignage de Jean-Claude Fauché,
recueilli par Bernard Zimmermann.
Les photographies présentées ici sont extraites d'un album de photos prises par Jean-Claude Fauché, soldat du contingent, en 1961-62. Il s'agit d'un ensemble exceptionnel de documents
témoignant de la vie quotidienne d'un appelé durant les 14 mois de la guerre d'Algérie précédant le cessez-le-feu du 19 mars.
J-C. Fauché, incorporé au camp de Souges, près de Bordeaux, a été versé au 57ème R.I. et affecté durant presque toute la durée de son service dans la Compagnie de Commandement d'Appui et de Services, au poste de Cap Aokas, près de Bougie.
Le "poste" était tenu par une section comprenant deux appelés français, un sergent la commandant et lui-même, et une harka de 21 hommes, des Algériens dont un n'était pas un harki mais un appelé. Les harkis étaient sous l'autorité directe d'un sergent harki ; ce dernier était un ancien maquisard rallié.
Les missions de la section consistaient en la garde du poste qui couvrait notamment le camp de prisonniers de Cap Aokas, où opéraient les hommes des Services de renseignement (il s'y pratiquait la torture) ; la section ouvrait quotidiennement la piste entre Cap Aokas et Tizi n'Berber, elle participait à des opérations de bouclage, de ratissage, elle pouvait être affectée à la protection des populations civiles européennes, par exemple le dimanche sur la plage de Tichi…
J-C. Fauché décrit ainsi les relations entre les appelés français et les harkis. "Je préférais les harkis aux appelés (algériens, Ndlr), parce que les appelés étaient là obligés ; les harkis étaient plus francs. Pourquoi étaient-ils là ? Je ne leur ai jamais posé la question de leurs motivations. Les plus engagés sont restés jusqu'au bout, quelques uns sont partis un peu avant la fin, peut-être parce qu'il y avait des pressions sur leurs familles. Nous avions une certaine méfiance vis à vis d'eux ; au poste, on ne mettait jamaisdeux harkis à monter la garde ensemble. A la station de pompage de Cap Aokas, tenue par des appelés français, avec un harki parmi eux, une nuit, la porte a été ouverte et tous les hommes ont été enlevés ; on ne les a jamais retrouvés. Les soupçons ont porté sur le harki ; on avait toujours cette crainte… Lorsque je suis arrivé au poste, les harkis ont commencé par me mener la vie dure. Mon ami, le sergent D. qui commandait le poste voisin, m'avait dit : "Ne te laisse pas faire, si tu as un problème avec eux, adresse-toi au sergent harki, il s'en occupera." Après, ça a été, parce qu'ils voyaient que je crapahutais avec eux…
Les harkis de la section étaient des hommes des villages kabyles des alentours. Un jour, le sergent a eu l'idée d'aller dormir dans la famille du sergent harki. Il avait une perm tous les mois, nous
sommes allés deux ou trois fois avec lui dans sa mechta ; c'était une cour avec une sorte de
murette et leur petit logement ; deux familles vivaient là. Le sergent avait sa mère et un frère ; ils nous ont bien accueillis ; la mère nous installait un matelas avec un oreiller. Jamais je n'aurais cru
que je dormirais dans une mechta comme en France. Nous ne faisions pas que dormir, on montait la garde aussi ! On mangeait avec eux, parlait un peu de tout, ils parlaient français mais entre eux en kabyle.
Je n'avais pas peur, au contraire, je trouvais ça super de sortir du poste, d'aller dormir dans une
mechta; j'étais inconscient. Comme le sergent avait sa perm qui tombait à intervalles réguliers, et que nous prenionstoujours le même chemin pour aller chez lui, les autres ont fini par nous tendre une embuscade. On s'en est bien sortis cette fois-là ; en face, il ont eu deux tués. Après cette affaire, le capitaine nous a interdit de retourner dormir à la mechta. Les harkis, eux, risquaient gros, car ils devaient laisser leurs armes au poste lorsqu'ils rentraient chez eux. C'étaient des guerriers, ils n'avaient pas peur d'aller au baroud. Aux maquisards, ils ne faisaient pas de cadeaux. Une fois, on a arrêté un jeune de 15-16 ans ; ils l'ont passé à tabac…
Le sergent harki a été tué dans une embuscade. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus."
|
 La harka de Cap Aokas en opération (à Bouhala, en zone rebelle)
La harka de Cap Aokas en opération (à Bouhala, en zone rebelle) |
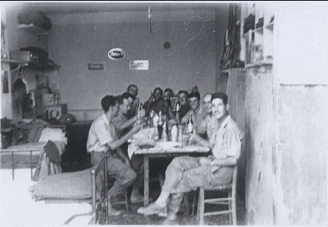
Fête de la harka
(intérieur du poste de Cap Aokas) |

Fête au mois de Ramadan 1961
(Poste de Cap Aokas) |

Drapeau pris aux maquisards à l'issue d'un accrochage
( au premier rang, accroupi, le sergent de la harka de Cap Aokas.) |
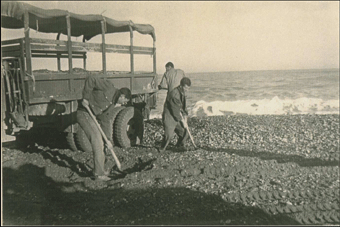
Prisonniers F.L.N. chargeant du sable
sous la garde de la harka de Cap Aokas |

Visite des familles
aux prisonniers du camp de Cap Aokas
(photo prise de la meurtrière de la tour du poste). |
Partie 5
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Elio Cohen-Boulakia, Soleil en Essonne, les commentaires sont de Sylvie Thenault
Charles-Robert Ageron, « Le drame des harkis en 1962 », in Vingtième siècle, revue d'histoire, n°42, avril juin 1994, pp. 3-6.
- « Les supplétifs algériens dans l'armée français pendant la guerre d'Algérie »a in Vingtième
siècle, revue d'histoire, n°48, octobre-décembre 1995, pp. 3-20.
- « Le « drame des harkis », mémoire ou histoire », in Vingtième siècle, revue d'histoire, n°68,
octobre-décembre 2000, pp. 3-15.
Charles Robert Ageron n'est intervenu sur cette question des Harkis que sous forme d'articles de revues. Sa première intervention en 1994 était une réaction à la thèse De Mohand Hamoumou, qu'il jugeait partiale et excessive. Il donnait raison à cette époque là aux autorités Françaises. Il a avec son deuxième et troisième article, il nuance son propos en admettant les responsabilités françaises.
Nordine Boulhaïs, Des harkis berbères, de l' Aurès au nord de la France, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2002.
Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie. Des soldats sacrifiés, Paris, L'Harmattan, 1995.
C'est un ancien militaire et pas un historien ; son ouvrage est une référence sur la question des massacres.
- Un village de harkis. Des Babors au pays drouais, Paris, L'Harmattan, 1994.
Mohand Hamoumou, Et ils sont devenus harkis, Paris, Fayard 2001 1ere éd° en 1993
Oeuvre de sociologue et non d'historien; il s'agit d'une commande d'associations de défense des Harkis; le livre publié en 1993 est devenu comme une manière de référence tout en soulevant de vives critiques chez les historiens(cf CR Ageron). Hamoumou entend augmenter le nombre des harkis en y amalgamant la population des caïds, bachagas mais aussi garde champêtre et toute autre fonction modeste par lesquelles certains algériens se voyaient reconnaître un parcelle d'autorité dans le système colonial. L'auteur veut montrer que
contrairement à la thèse du FLN, il y avait entre 1956 et 1961 une forte minorité de pro français. L'auteur enfin, assène sans le démontrer un chiffre excessif sur les massacres de 1962(150 mille, ce qui évoquerait un génocide)
Abd-El -Aziz Méliani, La France honteuse. Le drame des harkis, Paris, Perrin, 1993.
Très proche au début de l'ouvrage de la thèse d'Hamoumou
Chantal Morelle, « Les pouvoirs publics et le rapatriement des harkis en 1961-1962 » in
Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°83, juillet-septembre 2004, pp. 109-119.
Guy Pervillé, « La tragédie des harkis », in L'Histoire n° 140, janvier 1991, pp. 120-123.
- « Combien de morts pendant la guerre d'Algérie », in L'Histoire n° 53, février 1983, pp. 89-92.
Michel Roux, Les harkis, les oublies de l'histoire, La Découverte. 1991
Ouvrage retiré de la vente pour plagiat; en effet dans la 2ème partie M Roux pille la thèse de la socio ethnologue Saliha Abdellatif
Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou, Les harkis, une mémoire enfouie, Paris,
Autrement, coll « Français d'ailleurs, peuples d'ici », 1999.
Abderahmen Moumen, Les Français musulmans en Vaucluse. Installation et difficultés d'intégration d'une communauté de rapatriés d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2003.
La question des massacres et de son évaluation demeure une question minée.
On redécouvre le problème des massacres en le qualifiant de crime d'Etat: (judiciarisation de la question)
Boussad Azni, Harkis, crimes d'Ftat, généalogie d'un abandon, Paris, Ramsay, 2002.
Georges Fleury, Le combat des harkis, Paris, Les sept vents éditions, 1989.
Ahmed Kaberseli, Le chagrin sans la pitié, Dieppe, Clin d'oeil, 1988.
Bernard Moinet, Ahmed, connais pas._ Le calvaire des harkis, Paris, Athanor, 1989.
Pas de sources historiques, expérience personnelle relatée
Eric Taleb, La fin des harkis, Paris. La pensée universelle, 1972.
Il s'agit d'une autobiographie
Tom Charbit, Les harkis, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2005. - Rapport sur les harkis au camp de Saint-Maurice-L'Ardoise (Gard), disponible sur http://tomcharbit.free.fr
Il est sociologue, il ne fait pas oeuvre d'historien.
Fatima Besnaci-Lancou, Fille de harki (Préface de Jean Daniel et Jean Lacouture), Ed. de l’Atelier, 2003.
Incontournable témoignage.
Bernard Zimmermann, Soleil en Essonne renvoie aussi aux documents suivants :
La guerre d’Algérie Magazine, n°4, « Numéro spécial été 62 » : Harkis et Pieds-Noirs : le souvenir et la douleur, Juillet-août 2002.
Quatrième numéro d’une série de six, publiée en 2002. Intéressant mais difficilement trouvable. On y trouvera des articles de Mohand Hamoumou, Jean-Jacques Jordi, Jacques Frémeaux, Maurice Faivre, René Bail, Moumen Abderahmen, Daho Djerbal…
Stéphanie Abrial, Les enfants de harkis, de la révolte à l’intégration, L’Harmattan, 2002.
Essai partant d’une enquête sociologique pour une thèse de Sciences Po. Formation de l’identité sociale et politique des enfants de harkis. Esprit scientifique néanmoins en empathie avec ces derniers.
La Documentation Photographique, La guerre d’Algérie, Numéro 8022, août 2001.
Les auteures, Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault, n’y consacrent qu’une place minimaliste aux harkis, citant toutefois les publications de Charles-Robert Ageron dans leur bibliographie.
|